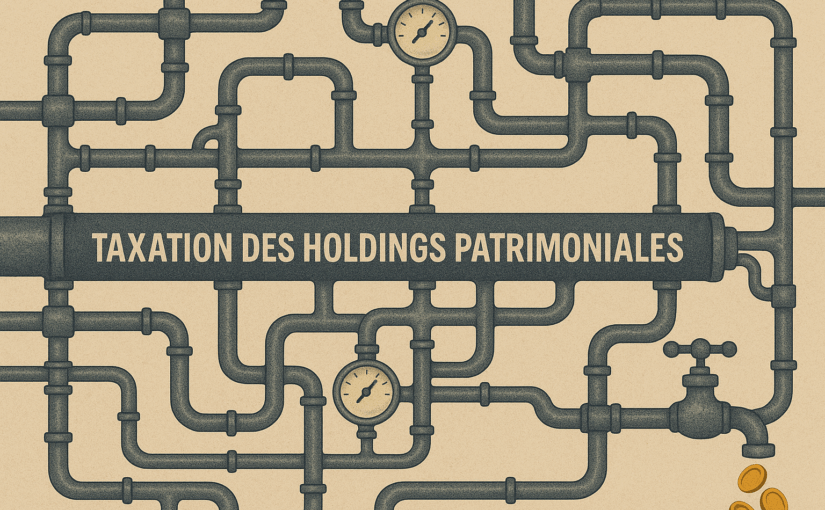Une des grandes nouveautés du projet de loi de finances 2026 réside dans son article 3, qui crée une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales. A peine proposée, la mesure fait déjà de toutes parts l’objet de critiques sur son rendement bien limité eu égard à son apparente ambition de taxer les plus fortunés. Cette façon de procéder ne fait toutefois pas justice des efforts réalisés par la Direction de la Législation Fiscale pour proposer une mesure ayant vocation à s’installer de manière durable dans le paysage fiscal français. L’objet de cette note de blog est précisément de pointer les éléments susceptibles d’en faire un texte appelé à durer, ainsi que ceux qui risquent de le faire échouer. Il ne s’agit pas, pour des raisons que nous évoquerons plus loin, d’en proposer des éléments chiffrés.
Un nouvel épisode de Sisyphe contre les fortunes dormantes ?
Pour comprendre l’esprit de ce texte, il faut évoquer brièvement quelques principes de la fiscalité du capital et, surtout, le fossé qui peut exister entre ces principes et la réalité. Ainsi, dans la note de l’IPP 92, nous avions pointé l’organisation patrimoniale qui mène à ce que les grandes fortunes professionnelles françaises paient, directement ou via leurs sociétés, moins d’impôt direct que les très hauts revenus d’activité et les patrimoines professionnels un peu plus modestes. Ce qu’il faut bien comprendre, c’est qu’il y a deux étages à cette “fusée”. Pour faire simple, alors que le revenu se distingue traditionnellement chez les économistes entre épargne et consommation, les législations fiscales font souvent la distinction entre une épargne « active », celle pour laquelle l’épargnant est un entrepreneur qui s’implique dans la vie de son investissement, et une épargne « passive », celle des comptes et livrets du citoyen lambda mais aussi celle investie par le citoyen mieux entouré dans un certain nombre d’enveloppes dédiées, dont les fameuses « holdings ». La régressivité que nous observons dans les données françaises vient certes du fait que cette épargne active est soumise à une imposition moins lourde mais aussi, pour une part difficile à déterminer, du fait qu’une partie de l’épargne passive bénéficie elle aussi d’une fiscalité directe plus légère que la part du revenu qui est consommée.
Le privilège fiscal de l’épargne qui-elle-ne-dort-pas des entrepreneurs se rencontre en effet très régulièrement dans notre code des impôts, qu’il s’agisse de l’imposition sur le stock (exclusion des biens professionnels de l’ISF-IFI, pactes Dutreil) ou les revenus du capital (taux d’IS plus bas que les taux marginaux supérieurs d’IR, abattements ou sursis d’imposition spécifiques sur les plus-values). On peut bien sûr discuter de l’opportunité d’un tel traitement, notamment car la proportion du revenu qui est « activement » épargnée augmente fortement avec la richesse. Il faut bien toutefois admettre que cette « carte blanche » accordée à l’épargne des entrepreneurs se retrouve à peu près partout dans le monde. Par exemple, après d’intenses débats académiques et politiques, l’administration Roosevelt décida elle-même en 1939 d’enterrer son idée d’un impôt sur les profits non distribués des entreprises commerciales (la Undistributed Profits Tax). N’ont survécu de cet épisode qu’un impôt sur l’accumulation de revenus non distribués non justifiée par « la conduite raisonnable de l’entreprise », la Accumulated Earnings Tax, et un impôt sur les revenus d’épargne “passive” de certaines sociétés, la Personal Holding Company Tax, sur laquelle nous reviendrons.
Le PLF 2026 ne sort absolument pas de cette logique, puisque la taxe sur le patrimoine financier n’est pas due sur la trésorerie que les entrepreneurs réinvestissent dans leur propre entreprise commerciale ou bien dans des souscriptions au capital de PME qui requièrent un profil de « business angel ». Ce n’est donc finalement qu’à fiscaliser un peu plus l’épargne passive des grandes fortunes que s’attache ce projet. Il en va toutefois de l’épargne comme des chasseurs, et les critères permettant de distinguer la « bonne » épargne active et la « mauvaise » épargne passive sont forcément flous et complexes en pratique. Comment en effet ne pas être tenté de faire passer pour de l’épargne active ce qui n’est que de l’épargne passive, voire même une forme de consommation ?
C’est là le terrain parfait d’un match de pinaillage entre d’un côté la communauté des fiscalistes et de l’autre le législateur, dont cette taxe est un nouvel épisode. 6 pages, une centaine d’alinéas, des raisonnements en récurrence et références à d’autres articles du code des impôts à foison, ça pique bien à la lecture, surtout pour seulement 900 millions d’euros de rendement officiellement espéré (on y reviendra). Une telle « usine à gaz » est toutefois absolument inévitable quand les contribuables touchés ont des moyens de recours aussi extensifs. On espère d’ailleurs que les lecteurs attentifs de cet article 3 du PLF 2026 auront gardé assez de force pour la lecture des inévitables recours qui seront portés contre ce texte et son application.
La taxe sur le patrimoine financier est-elle une innovation radicale ?
Une lecture suffisamment attentive du texte révèle toutefois la mise en place en droit fiscal français de très sérieuses innovations. L’alourdissement de la fiscalité sur l’épargne passive des plus aisés bute en règle générale sur plusieurs principes généraux du droit fiscal, mais le plus important d’entre eux est probablement celui de la personnalité de l’impôt : on ne peut payer pour un autre que soi, et en particulier une personne physique ne peut pas payer pour une société de capitaux, quand bien même la première contrôlerait totalement la seconde (y compris à l’extrémité suivante : un seul actionnaire, pas de dettes, aucune règle de gouvernance prescrite de l’extérieur). Cette nouvelle taxe renverse la focale : puisque la personne physique ne peut pas payer pour les revenus de la société, pourquoi ne pas plutôt faire payer directement les sociétés qui ont tendance à faire passer en revenu activement réinvesti des revenus presqu’aussi passivement épargnés que dans un livret, voire effectivement consommés ?
La page introductive de l’article de loi est ainsi une définition d’un nouveau type de société, la « holding patrimoniale », et un large faisceau d’indices est employé pour ce faire : composition du capital (une famille résidente en France détient plus du tiers des parts, en incluant les liens de détention indirects), prise en compte des groupes (seule une unité du groupe doit payer pour l’ensemble, la trésorerie interne au groupe est exemptée), composition des revenus (plus de 50% des profits doivent être « passifs »), et même principes de gouvernance (une personne physique doit exercer en fait le pouvoir de décision).Il s’agit là d’éléments qui auraient pu (dû ?) depuis longtemps figurer dans la boîte à outils de la fiscalité française. On est en effet très proches des critères employés par le droit fiscal américain depuis près d’un siècle pour définir les contribuables de la Personal Holding Company Tax. Le paradoxe de cette nouveauté pour la France c’est qu’on est bien en peine de fournir des statistiques précises sur l’identité des potentiels contribuables, faute de renseignements fiables sur tous ces éléments de capital et de gouvernance. C’est peut-être à cette aune qu’il faut lire le critère, d’apparence assez grossier, de la valeur vénale du bilan total supérieure à cinq millions d’euros. Avec des données fiables, il aurait en effet été beaucoup plus sensé de constituer un barème en fonction de l’assiette réelle de la taxe, qu’il s’agit maintenant d’évoquer.
Ce nouveau dispositif arrive-t-il à la cheville de son équivalent américain ?
En effet, le lecteur un peu amateur de droit fiscal comparatif peut s’étonner de la mise en place d’une assiette qui ne semble en revanche pas beaucoup ressembler à la Personal Holding Company Tax américaine. Aux Etats-Unis, c’est le flux des dividendes stockés qui est taxé ; avec cette proposition de taxe française, c’est le stock de dividendes accumulés qui est visé. Qui a bien lu la note IPP 92 saura pourquoi l’assiette américaine n’a pas été choisie par ceux qui ont écrit le PLF 2026 : la directive mère-fille empêche la taxation de plus de 5% des dividendes intra-groupe. Si une grande multinationale distribue en 2025 3 milliards d’euros à une holding la contrôlant, aucune loi ne peut imposer cette dernière sur plus de 150 millions d’euros au titre de cet exercice. Devant l’interdit européen, ce que ce texte se propose de faire, c’est de taxer le stock des dividendes de la multinationale en question qui sont accumulés dans sa holding de contrôle dans un but autre que celui de prendre des participations importantes dans divers projets commerciaux. En effet, à ma connaissance, si taxer le dividende intra-groupe est interdit par le droit européen, rien n’empêche de taxer le stock de dividendes ainsi accumulés par une société. Une équivalence entre les assiettes de la taxe française et la taxe américaine peut en particulier être faite sous l’hypothèse que les dividendes reçus par la holding sont systématiquement réinvestis dans des placements visés par la taxe française.
La question devient donc alors de savoir si l’assiette taxable est suffisamment large pour inclure tous les placements possibles des dividendes reçus. C’est précisément l’objet de la moitié de ces six pages du PLF, ce qui permet déjà de comprendre que de nombreux placements possibles ne sont pas inclus. Cette limitation des actifs taxables semble toutefois avoir pour principal objectif de ne pas taxer le revenu de l’entrepreneur qui est réinvesti dans des entreprises auxquelles il est susceptible d’apporter une valeur ajoutée. Aux Etats-Unis, il n’y a, de fait, pas beaucoup d’exemples d’entrepreneurs qui aient dû payer de lourds impôts simplement pour renforcer leur poids au capital ou bien commencer de nouveaux projets entrepreneuriaux. C’est qu’il est en effet possible à peu de frais fiscaux de procéder à des rachats d’actions ciblés sur les investisseurs minoritaires, de contracter des prêts entre entreprises ou bien gagés sur les parts de l’entreprise de départ ou, plus simplement, de réinvestir par le biais de l’entreprise de départ et diversifier son activité. En fin de compte, c’est donc seulement à l’aune de leur capacité respective de fiscaliser l’épargne passive des entrepreneurs et de protéger leur épargne active qu’il faut comparer les taxes française et américaine.
Une assiette trop trouée pour mettre fin aux holdings ?
C’est notamment à un titre qu’il faudra particulièrement surveiller la mise en place du projet français : peut-on vraiment s’attendre à ce que le projet décourage la mise en place de holdings à but principalement fiscal ?
Tout d’abord, la distinction entre, d’un côté, les biens taxables et, de l’autre, les biens affectés à une activité économique “réelle” et donc non taxables, est forcément sujette à débat et donc à optimisation. Il existe toutefois une jurisprudence très active sur ce sujet dans le cadre de l’application des pactes Dutreil, qui fixe des critères de plus en plus précis s’agissant des cas limites que sont l’immobilier et les holdings dites “actives”. Mais tout cela suggère justement l’importance pour ceux qui participent au débat sur ces sujets de s’intéresser plus à cette jurisprudence, quitte à la réinterroger si nécessaire.
Ensuite, en reposant sur une assiette de valeur d’actifs pour lesquels souvent peu de références de marché crédibles existent, le dispositif se prête à d’éventuelles sous-valorisations de la fortune taxable, d’autant plus probables qu’il s’agit de sous-éléments du tout qu’est le bilan d’une entreprise. On sait bien par exemple qu’en procédure de faillite, la valeur vénale individuelle des actifs liquidés est souvent largement inférieure à la valeur vénale de l’ensemble.
Surtout, une attention bien particulière doit être portée à l’éventuelle possibilité de contourner la taxe sur les holdings patrimoniales françaises en apportant ses titres à une holding étrangère. C’est justement pour empêcher ce type d’évitement que, seulement trois ans après la mise en place de la Personal Holding Company Tax, le Congrès américain décida en 1937 de mettre en transparence l’ensemble des revenus obtenus par des holdings sises à l’étranger mais contrôlées par des résidents fiscaux américains. Le texte français s’inspire là encore fortement de cet exemple, puisqu’il prévoit la mise en place d’une taxe jumelle sur les holdings étrangères remplissant exactement les mêmes critères que les holdings patrimoniales françaises. A une (grosse) différence près que, comme aux Etats-Unis, cette taxe jumelle est due non pas par la société elle-même (et pour cause, puisque cette dernière n’est pas résidente en France), mais par la personne physique détenant la holding étrangère, qui devra faire porter la valeur taxable de ces parts dans sa déclaration d’IR.
En cas de détention de parts de holdings étrangères, et dans ce cas seulement, le dispositif envisagé s’apparente donc bel et bien à un mini-ISF. La question risque alors vite de devenir dans quelle mesure la riche jurisprudence de l’ISF s’appliquera à cette version de la taxe sur le patrimoine financier. Le sujet peut paraître mineur de prime abord, mais l’envergure budgétaire de la mesure dépendra fortement de comment ce versant du dispositif évoluera, puisque dès aujourd’hui certaines des plus grandes fortunes professionnelles de notre pays font appel à des holdings étrangères.
Faut-il s’inquiéter du faible rendement de la mesure ?
Venons-en donc à la question du rendement de cette taxe qui, en particulier dans le contexte budgétaire tendu que nous vivons, vient forcément à l’esprit. Ce premier parcours du dispositif doit toutefois permettre de comprendre que le sujet du rendement ne peut pas être à ce stade l’angle principal d’analyse. Comme cela a déjà été évoqué, personne ne dispose à l’heure actuelle de données suffisamment précises et récentes sur la composition du capital et la valorisation des actifs taxables. On en saura de fait beaucoup plus sur ces éléments-clés si et une fois que la taxe est effectivement mise en place au moins une fois, y compris pour les holdings étrangères.
Ensuite, les réponses comportementales peuvent être très conséquentes et faire de cette mesure un gadget sans rendement si elle laisse ouvertes de nombreuses possibilités d’optimisation. Ce qui est paradoxal, toutefois, c’est que l’objet même de cet article du PLF 2026 est de maximiser les réponses comportementales vertueuses qui, en mettant fin aux utilisations principalement fiscales des holdings, feraient circuler la fortune vers des usages plus socialement profitables. Ainsi la Personal Holding Company Tax, dont s’inspire fortement l’article 3 du PLF, n’avait rapporté à son lancement en 1935 que 0,004% du PIB états-unien pour un taux de 30% en sus des autres impôts directs perçus, et rapporte encore moins aujourd’hui : 0,0001% du PIB pour un taux de 20%. Ce montant structurellement minuscule n’a pourtant jamais incité le législateur américain à remettre en cause cette taxe. C’est bien là le signe qu’un bon impôt peut avoir un rendement faible s’il accroît les recettes d’impôt sur le revenu (via des distributions personnelles plus généreuses) ou d’impôt sur les sociétés (via des réinvestissements à haut rendement dans l’économie réelle). Cela montre aussi qu’on ne peut analyser le taux de la taxe, ici fixé à 2% (et donc dans la fourchette haute des taux habituellement observés sur l’IFI et feu l’ISF), comme on le ferait pour analyser des impôts qui n’ont pas pour objet de faire disparaître leur assiette. Espérons maintenant que le débat à venir sur cette mesure sera à la hauteur des attentes équilibrées que l’on en nourrit à ce stade.